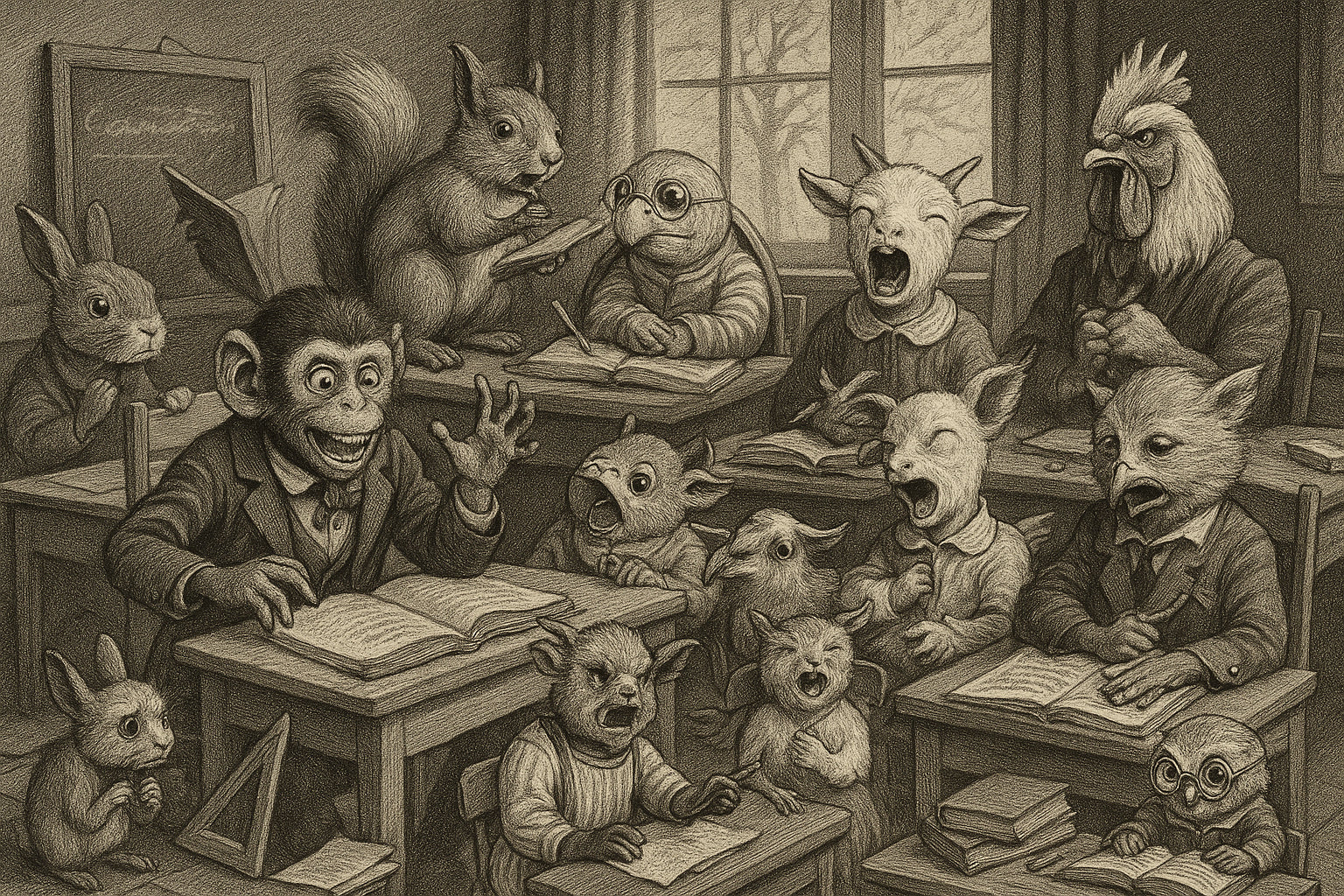
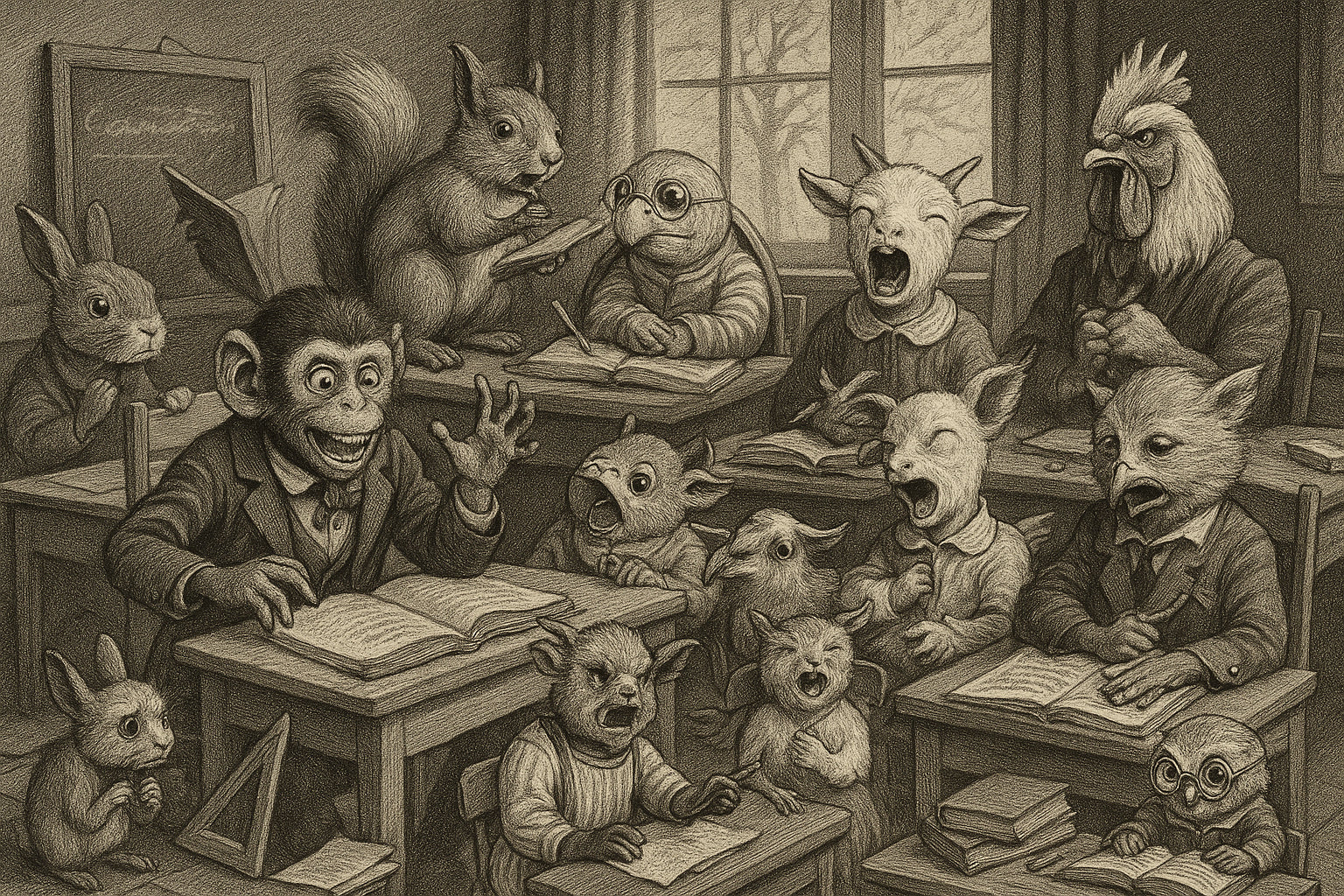
Les 12 Troubles Émotionnels et du Comportement chez l’Enfant
Les troubles du comportement chez l’enfant prennent des formes multiples : TDAH, hyperactivité, anxiété, troubles du sommeil…
Dans cet article signé Pamplemoon, nous dressons une liste aussi complète que possible de ces difficultés. Chacun de ces thèmes sera développé dans des articles dédiés, pour offrir aux parents un éclairage plus précis et adapté.
1. TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité)

Le TDAH fait partie des troubles les plus répandus de l’enfance. On estime qu’il touche 3 à 5 % des enfants d’âge scolaire, soit presque un élève par classe. Il se manifeste tôt, souvent avant l’âge de 12 ans, et peut se prolonger à l’adolescence.
Il existe deux grandes façons de le vivre. Chez certains enfants, le trouble prend la forme d’une hyperactivité incessante : besoin de bouger, de parler, d’agir sans attendre. Ces enfants sont parfois surnommés “piles électriques”.
Chez d’autres, au contraire, il se présente sans hyperactivité : l’enfant semble s’évader dans ses pensées, oublie les consignes, paraît toujours ailleurs — “dans la lune”, comme disent les enseignants. Dans les deux cas, l’attention leur échappe facilement, comme du sable entre les doigts.
Les familles se sentent souvent épuisées. Entre les devoirs interminables, les colères imprévisibles et la comparaison avec des camarades plus “sages”, le quotidien devient lourd. Pourtant, le TDAH n’est pas un caprice ni un défaut d’éducation. C’est un trouble reconnu, qui demande une approche patiente, structurée et respectueuse, afin d’aider l’enfant à trouver son équilibre.
2. Hyperactivité

L’hyperactivité attire le regard immédiatement. L’enfant ne tient pas en place : il court, grimpe, interrompt, parle sans relâche. À table, il se lève avant la fin du repas ; à l’école, il balance sur sa chaise, touche à tout, lève la main puis oublie sa question. Son énergie semble inépuisable, comme s’il avait un moteur intérieur qu’aucun bouton “pause” n’arrive à éteindre.
Elle peut exister sans TDAH. Certains enfants sont simplement très vifs, curieux, avides de découvertes. Mais quand cette énergie déborde au point de perturber l’apprentissage ou les relations avec les autres, l’hyperactivité devient un vrai défi éducatif. Elle épuise les parents, agace les enseignants, et laisse parfois l’enfant lui-même frustré, car il sent bien qu’il déborde du cadre attendu.
Il ne s’agit pas d’un défaut de caractère. Derrière cette agitation, il y a souvent un besoin immense de mouvement, de stimulation, parfois de reconnaissance. Accueillir cette énergie sans la brider totalement, lui offrir des espaces pour s’exprimer (sport, activités créatives), tout en posant des limites claires, peut transformer ce tourbillon en force constructive.
3. Manque de concentration

Le manque de concentration est une inquiétude fréquente chez les parents. L’enfant rêve au lieu d’écouter, oublie ses affaires, bâcle ses devoirs ou se perd dans ses pensées. On le retrouve parfois, le regard perdu à la fenêtre, comme happé par un univers intérieur plus fascinant que la dictée en cours.
Il ne s’agit pas toujours de TDAH. La concentration peut s’échapper pour mille raisons : la fatigue, qui rend l’esprit brumeux ; l’anxiété, qui détourne l’attention vers des peurs invisibles ; ou simplement un manque d’intérêt pour une tâche jugée trop répétitive ou trop difficile. Observer le contexte aide à mieux cerner l’origine du décrochage.
Ce n’est pas seulement une question scolaire. Le manque de concentration pèse aussi sur la vie quotidienne, et les parents oscillent entre inquiétude et agacement. Accepter que certains enfants aient besoin de pauses plus fréquentes, ou d’un environnement apaisé peut transformer cette faiblesse apparente en rythme singulier qu’il faut apprendre à respecter.
4. TSA (trouble du spectre de l’autisme)

Le TSA regroupe une grande diversité de profils. Certains enfants parlent peu ou tardivement, d’autres développent un langage riche mais peinent à l’utiliser dans les échanges quotidiens. Certains aiment répéter les mêmes gestes ou s’attacher à des routines immuables ; d’autres se passionnent pour un sujet très spécifique, avec une intensité étonnante.
Il n’existe pas “un” autisme, mais des formes multiples. On parle parfois d’autisme “léger”, d’autisme avec troubles associés, ou encore du syndrome d’Asperger. Tous ces termes rappellent une réalité : chaque enfant autiste avance à sa manière, avec ses forces et ses défis.
Les signes apparaissent tôt, et persistent dans le temps. Difficultés de communication, évitement du regard, réactions intenses face aux bruits ou aux changements : autant de petits signaux qui peuvent alerter les parents. Mais derrière ces particularités se cache souvent une grande sensibilité au monde, qu’il faut apprendre à décoder.
Les familles jouent un rôle essentiel. Accompagner un enfant autiste demande patience, respect du rythme, et beaucoup d’observation. Plus qu’une “correction”, c’est un chemin pour comprendre une autre façon d’être au monde, où la différence devient aussi une richesse.
5. Hypersensibilité

L’hypersensibilité amplifie toutes les émotions. L’enfant rit plus fort, pleure plus vite, s’emporte plus intensément. Une remarque d’enseignant peut être vécue comme une blessure profonde ; un film un peu triste peut déclencher des larmes incontrôlables. Chaque expérience semble traversée avec une intensité décuplée, comme si le volume émotionnel était réglé sur “maximum”.
Il est important de rappeler que l’hypersensibilité n’est pas un trouble médical. Elle ne figure dans aucun manuel de diagnostic, et pourtant, de nombreux parents utilisent spontanément ce mot pour décrire leur enfant. Cela traduit une réalité vécue : certains enfants paraissent plus perméables aux ambiances, aux bruits, aux injustices, aux émotions des autres.
6. Peurs excessives

Les peurs font partie du développement normal de l’enfant. Elles apparaissent à différents âges, presque comme des étapes incontournables : la peur du noir; la peur des monstres ; la peur de la mort… Ces angoisses passagères sont universelles : elles racontent la façon dont l’enfant apprivoise le monde et ses mystères.
Mais parfois, ces peurs prennent trop de place. Quand un enfant refuse obstinément de dormir seul, quand chaque séparation déclenche une panique disproportionnée, ou quand de petites inquiétudes se transforment en une multitude de phobies, les parents s’interrogent et s’inquiètent.
Leur rôle est délicat : rassurer sans surprotéger. Offrir un cadre sécurisant, reconnaître la peur sans la ridiculiser, inventer des rituels rassurants… autant de gestes qui aident l’enfant à reprendre confiance.
7. Anxiété

L’anxiété dépasse la simple peur. Alors que la peur a un objet précis — l’ombre dans la chambre, le bruit derrière la porte —, l’anxiété s’installe comme une toile de fond. L’enfant vit dans une inquiétude diffuse et tenace : peur d’échouer, peur d’être jugé, peur de décevoir, peur même de ce qu’il ne sait pas encore nommer.
Elle peut se manifester à tout âge, et sous bien des formes. Certains enfants se plaignent chaque matin de maux de ventre avant l’école ; d’autres peinent à s’endormir, leur esprit encombré de scénarios inquiétants.
Face à un enfant anxieux, l’écoute et la douceur deviennent essentielles. Il ne s’agit pas de minimiser son ressenti, ni de le rassurer à tout prix, mais de lui montrer qu’il n’est pas seul avec ses tourments.
8. Angoisse de séparation

Quitter ses parents est une véritable épreuve pour certains enfants. Pleurs, cris, refus d’aller à l’école ou à la crèche… L’angoisse de séparation est fréquente entre 8 mois et 3 ans, quand l’enfant prend conscience qu’il est une personne distincte de ses parents. Cette étape, bien que difficile, fait partie du développement normal.
Un rituel rassurant peut transformer cette transition. Un geste, un mot secret, un objet symbolique — doudou, foulard, petite brume parfumée — peut devenir le fil invisible qui relie l’enfant à son parent. Cela permet d’offrir une passerelle douce pour l’aider à franchir peu à peu cette étape incontournable.
9. Violence physique (contre les parents ou camarades)

Un enfant violent ne cherche pas à faire le mal. Derrière un coup, une morsure ou une bousculade, il y a souvent un trop-plein d’émotions qui déborde. Quand les mots manquent, c’est le corps qui parle — parfois avec brutalité.
Ces gestes désarment les parents. Ils ne sont pas la preuve d’une “mauvaise éducation”, mais l’expression d’un cœur qui ne sait pas encore comment dire sa colère, sa jalousie, ou sa frustration.
La réponse doit être claire mais enveloppée de douceur. L’enfant a besoin d’entendre que la violence blesse, tout en découvrant d’autres chemins pour exprimer ce qu’il ressent : nommer sa colère, souffler fort, bouger autrement. Dans un cadre stable et rassurant, il apprend peu à peu à troquer ses coups contre des mots.
10. Frustration

La frustration déclenche des colères spectaculaires. Certains enfants hurlent, tapent du pied, se roulent au sol quand on leur refuse quelque chose.
Ces crises sont normales à certains âges. Mais si elles deviennent quotidiennes et explosives, elles perturbent la vie familiale. L’enfant a besoin d’apprendre la patience et le “non” tolérable.
11. Troubles du sommeil

Le sommeil est souvent le miroir de l’équilibre émotionnel. Quand la nuit se trouble, c’est que quelque chose dans la journée pèse encore. Cauchemars, réveils nocturnes, difficultés à s’endormir : autant de signes qui rappellent que l’esprit de l’enfant ne parvient pas toujours à trouver le repos.
Ces troubles sont fréquents, mais rarement anodins. Ils peuvent être l’écho d’une anxiété persistante, de peurs encore vives ou d’une énergie débordante qui refuse de s’éteindre. Dans bien des cas, un mauvais sommeil n’est pas la cause première, mais le symptôme d’un déséquilibre plus large, une façon pour le corps de dire ce que le cœur ou la tête n’arrivent pas à exprimer.
Aider un enfant à mieux dormir, c’est l’écouter avant de l’endormir. Le rassurer, comprendre ses peurs, installer un rituel tendre et régulier : autant de gestes qui transforment la nuit en refuge, plutôt qu’en épreuve.
12. HPI (haut potentiel intellectuel) et comportements associés

Le HPI n’est pas un trouble, mais un profil singulier. Ces enfants apprennent vite, posent mille questions, s’ennuient facilement à l’école et semblent parfois avancer à une vitesse différente de leurs camarades. Leur curiosité insatiable émerveille, mais peut aussi dérouter.
Cette intensité s’accompagne de fragilités. Hypersensibilité, sentiment d’isolement, crises de colère ou découragement soudain : leur richesse intérieure demande une attention particulière. Ils ont besoin d’être compris dans leur rythme unique, de trouver des espaces où leur différence n’est pas un poids mais une force à cultiver.
Conclusion
Les troubles du comportement chez l’enfant recouvrent des réalités très diverses : de l’hyperactivité passagère à l’anxiété persistante, en passant par les peurs ou le manque de sommeil. L’essentiel est de rester attentif, bienveillant et d’éviter les solutions brutales.
Le conseil de Pamplemoon : testez des approches douces, comme les hydrolats et les rituels sensoriels, qui accompagnent l’enfant dans son équilibre émotionnel, sans effets secondaires. Écouter, observer, rassurer : voilà la meilleure base pour l’aider à grandir sereinement.
Découvrez les Brumes d'Hydrolats Bio chez Pamplemoon
-
Brume Anti-Colères à l'Hydrolat Bio de Lavande Fine pour Enfants
Prix habituel 22,00€Prix habituelPrix unitaire / par -
Brume Bododo à l'Hydrolat Bio de Tilleul pour Enfants
Prix habituel 22,00€Prix habituelPrix unitaire / par -
Brume Anti-Monstres à l'Hydrolat Bio de Rose pour Enfants
Prix habituel 22,00€Prix habituelPrix unitaire / par







